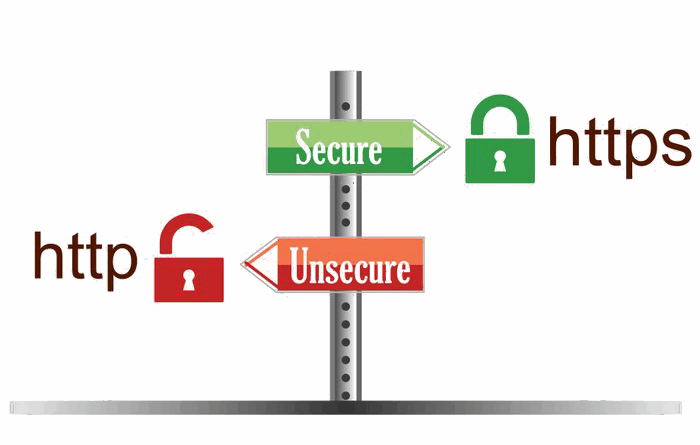Science et sécurité
La sécurité et la sûreté se développent, des regroupement de professionnels se créent, mais la science n’est que peu voire pas du tout invitée à apporter sa contribution à leur développement. Sécurité et sûreté seraient-elles tellement spécifiques que la science ne serait d’aucune utilité pour elles ? L’art de leur mise en œuvre serait-il si particulier qu’il serait inné chez certains, inexistant chez d’autres ? Notre thèse de doctorat montre au contraire qu’il existe dans la sûreté une partie normée qui s’enseigne et une partie prudentielle qui s’acquiert avec l’expérience. Alors, d’où vient ce peu d’appétence des praticiens pour l’étude de leur discipline ? D’autant que, dans le domaine de la guerre, souvent présenté comme tout aussi inné que la sûreté, de grands capitaines ont déclaré qu’ils devaient beaucoup à l’étude et au travail. Hervé Coutau-Bégarie en cite quelques-uns dans son Traité de stratégie : Sur le champ de bataille, l’inspiration n’est le plus souvent qu’une réminiscence. Ce n’est pas un génie qui me révèle tout à coup, en secret, ce que j’ai à dire ou à faire dans une vue inattendue pour les autres, c’est la réflexion, la méditation. (Napoléon). Faites bien voir que les qualités du général, du moins en ce qui me concerne, résulteraient de la compréhension, d’un dur travail, d’un esprit toujours à l’œuvre et concentré. Si cela m’était venu facilement, je n’aurais pas si bien réussi. (Lawrence). La théorie qui veut toujours marcher de pair avec l’expérience se venge tôt ou tard d’avoir été trop négligée. (Kléber). On ne devient grand capitaine qu’avec la passion de l’étude, et une longue expérience. Cet adage si rebattu de nos jours, que l’on naît général et qu’on a pas besoin d’étude pour le devenir, est une des nombreuses erreurs de notre siècle, un de ces lieux communs qu’emploie la présomption et la nonchalance, pour se dispenser des efforts pénibles qui mènent à la perfection. (Archiduc Charles). Enfin, last but not least, celui qui est considéré comme un des maîtres de la stratégie, Clausewitz lui-même écrivit : la théorie sert à faire la lumière sur la masse des objets, pour que l’entendement trouve plus facilement son chemin ; elle sert à extirper les mauvaises herbes que l’erreur a semées partout, à montrer les rapports mutuels des choses, et à séparer ce qui est important de ce qui est secondaire.
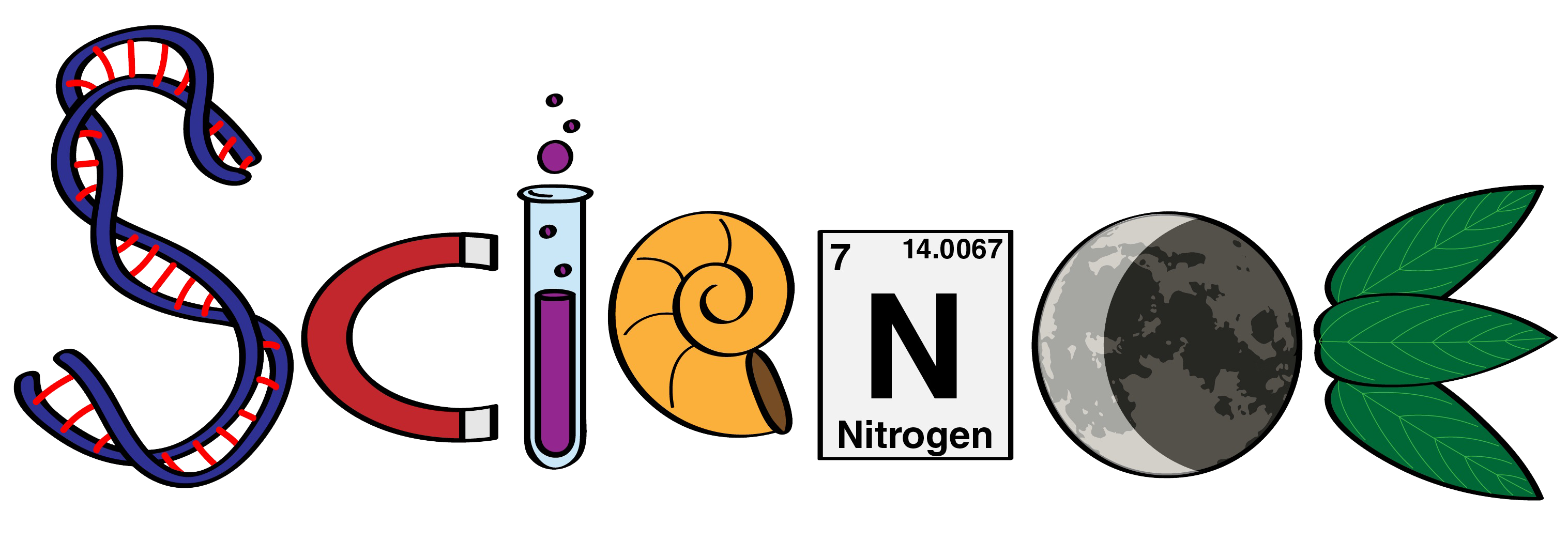
Ces citations jettent une lumière plus crue sur le désintérêt de l’étude de la sécurité et de la sûreté par les praticiens. D’autant que, plus près de nous dans le temps, le directeur de la DGSE a reconnu travailler avec des scientifiques, prouvant ainsi, à rebours de ceux qui estiment que les contributions scientifiques sont trop « théoriques, universitaires », qu’il est possible que praticiens et scientifiques travaillent ensemble. Si une telle coopération est possible, quels en sont les acteurs et les gains qu’ils peuvent en espérer ?
L’État
A tout seigneur tout honneur, l’État sera le premier étudié car il est chargé de maintenir l’ordre public pour assurer la tranquillité et la paix publique auxquelles ses citoyens aspirent. Cela passe donc par une lutte contre le crime et les organisations criminelles qui sont de plus en plus étudiées par des universitaires. Ces études concernent également l’organisation de ces groupes criminels, leur fonctionnement ainsi que leurs modes d’actions. La connaissance de ces éléments est indispensable à l’État qui souhaite les combattre. L’étude comparative des stratégies de lutte contre ces groupes est également utile afin d’identifier ce qui s’est avéré efficace dans d’autres pays, et ses modalités de transposition en France. Tourner les regards vers l’Amérique Centrale permettrait sûrement de comprendre pourquoi le Mexique est encore la proie d’une certaine insécurité, alors que le Salvador a réglé cette question, son président ayant déclaré (entre autres) : Il n’y a pas de gouvernement qui ne puisse mettre fin à la criminalité. Si un gouvernement ne met pas fin à la criminalité dans son pays, c’est que la criminalité est devenue une partie du gouvernement.
Pour lutter efficacement contre les criminels et empêcher ou réprimer leurs actions, il faut développer des moyens adaptés aux modes d’action constatés. Se renseigner sur les groupes de casseurs et les arrêter peut s’effectuer avec le marqueur à distance (MADI), mais il reste absent de l’arsenal officiel alors qu’il est au point depuis plusieurs années et permettrait de pacifier les cortèges ; la combativité des avocats de Cédric Jubillar montre qu’il est indispensable non seulement de mieux former les enquêteurs à soutenir les accusations des avocats mais aussi qu’une méthode d’enquête voie enfin le jour car il n’y en a toujours pas (cf. ce billet). Il demeure étonnant que les études et travaux réalisés soient aussi peu mis à profit par les forces de l’ordre.
Ajoutons que, dans son rôle de protection des citoyens, l’État devrait également, pour mener une politique adaptée à l’époque actuelle, s’inspirer des études relatives aux effets des changements climatiques en cours. Faute de cela, les catastrophes auront encore des effets aussi désastreux que les inondations ayant frappé la région de Valence fin octobre 2024. Rappelons qu’à cette occasion, le premier ministre avait fui les lieux sous les huées des habitants alors que le roi avait fait face aux remontrances des Espagnols sinistrés.
En France, l’État qui accepte (pas toujours de bonne grâce) les suggestions tactiques devrait réaliser que, se voulant stratège, il est dépassé : sa posture est le plus souvent réactive, y compris à l’occasion d’événements prévus de longue date et qui ne constituent pas un problème dans d’autres pays comme les finales de coupe d’Europe de football (voir ici) . Notons que cette finale de 2021 a fait l’objet d’un rapport du Sénat et que les étrangers ont été stupéfaits de ce chaos. Une façon de se reprendre consisterait à définir une doctrine, une stratégie, un cadre d’emploi de ses forces. Pour cela, il serait vraiment utile que les directeurs de services de sécurité montrent l’exemple et encouragent la réflexion relative à la sécurité. Mais il est vrai qu’ils sont nommés par des politiques qui préfèrent les coups d’éclat médiatiques (pardon, des quick wins) au travail à long terme. Revoir la formation des forces de l’ordre pour moins l’axer sur le droit et la focaliser davantage sur la connaissance des phénomènes criminels et les moyens de lutter contre serait tout aussi pertinent.
L’entreprise
L’État n’est cependant pas le seul qui gagnerait à encourager la production de travaux scientifiques relatifs à la sûreté et à les mettre en application. Les entreprises, plus particulièrement celles qui bénéficient des services d’une direction sûreté négligent encore la production scientifique. Pourtant, un nombre non négligeable de leurs sujets d’intérêt ont déjà été traités par des scientifiques. Une bonne partie des sujets auxquels elles sont confrontées ont déjà été abordés par des scientifiques. La science est en mesure d’aider l’entreprise et ses praticiens à définir la sûreté, sa juridiction, renouveler son appellation, étudier la légitimité de son directeur ainsi que le rapport entre fiabilité et formation (thèmes traités dans notre thèse de doctorat) mais aussi à construire des indicateurs, résoudre la question du centre de coût ou de profit, celle de la chaîne de valeur… Il existe nombre de travaux scientifiques qui répondent aux questions posées mais, tel le MADI évoqué supra, personne ne s’y intéresse. Cette étonnante attitude plonge ainsi l’entreprise dans un scénario digne d’Un jour sans fin puisque, négligeant des pistes d’amélioration existantes, elle est de fait condamnée à répéter les mêmes erreurs et se poser les mêmes questions jusqu’à…
La prise en compte des travaux scientifiques l’aiderait à choisir des prestataires en objectivant son choix. Cela est particulièrement vrai lorsqu’il s’agit de choisir des logiciels permettant de « mettre de l’intelligence » dans la prise de décision via l’intelligence artificielle. Malgré ces intentions qui peuvent paraître louables (mais peut-on vraiment réduire l’incertitude à néant ?) le choix ne se fonde pas sur la connaissance réelle des capacités du logiciel mais sur le discours commercial. Nous apprenons ainsi (via le site internet du fournisseur) que les solutions de qualité gouvernementale garantissent une identification et une authentification biométriques performantes, impartiales et sans friction dans les mondes physique et numérique (source) sans fournir de métrique ni d’explication des termes utilisés et que La technologie de reconnaissance faciale d’IDEMIA se classe première pour le critère d’équité, ce qui confirme que la technologie d’IDEMIA conserve ses performances exceptionnelles en matière de précision, sur tous les groupes démographiques (source) sans plus de précisions. La matrice de confusion qui permet d’évaluer le gain permis par le logiciel en calculant différents paramètres existe pourtant depuis de nombreuses années. S’il est compréhensible que des fournisseurs de solution se montrent discrets sur les valeurs de cette matrice pour leurs produits, il est étonnant que les entreprises ne les demandent pas. Il peut aussi arriver que le dit fournisseur refuse de fournir les valeurs de cette matrice sous des motifs spécieux (cas vécu il y a quelques mois), ce qui donne de lui une bien piètre image…
L’université
La recherche scientifique relative à la sûreté est liée à l’investissement que l’université y consacre. La défiance université-acteurs de la sécurité qui rendait les deux mondes étanches l’un à l’autre s’amoindrit au fil du temps, et cette meilleure compréhension (bien que perfectible) permet des avancées intéressantes. Ainsi, le Largepa s’est investi dans l’exploration du management de la sécurité et l’école des sciences criminelles de Lausanne étudie depuis plus d’un siècle le crime et ses manifestations. L’un de ses professeurs a d’ailleurs amplement participé à la mise au point du NIRLab qui permet en quelques secondes, par l’utilisation d’une IA et la consultation d’une base de données importante, d’obtenir le profil des stupéfiants saisis, le résultat de cette analyse étant reconnu par les magistrats Suisses. Nous ne pouvons donc que regretter que, comme c’est le cas pour le MADI, les forces de l’ordre françaises n’en soient pas encore dotées, ni même la Marine Nationale qui détruit illico les produits saisis dans le cadre de l’action de l’État en mer, se privant ainsi de précieux renseignements sur la qualité des produits, ce qui permettrait de remonter aux laboratoires qui les fabriquent.
Quant à l’investigation criminelle, s’il manque encore une méthode d’enquête (le procès Jubillar a mis le doigt dessus), les quelques universités qui s’intéressent à la science forensique (dans le monde francophone l’école des sciences criminelles déjà citée et l’Université du Québec à Trois-Rivières, dans le monde anglophone l’UTS à Sydney) ont mené des travaux intéressants. C’est le cas de la sphère d’investigation (théorisée par les professeurs Ribaux et Delémont de l’ESC) dont la prise en compte est bien utile lorsque la scène de crime n’est pas identifiée (cas notamment des affaires Emile et Jubillar) et de l’identification des phases du travail d’investigation où se situe l’incertitude, phases qui seront logiquement attaquées par les avocats de la défense lors du procès pénal, l’affaire Jubillar en étant l’exemple le plus récent. (Remerciements au professeur Crispino pour les deux illustrations précédentes). Applicable à l’investigation criminelle et tout aussi utile au directeur sûreté, la déclaration de Sydney montre qu’une mobilisation internationale de chercheurs et de praticiens peut être fructueuse.
Les citoyens
Bénéficiaires de la tranquillité publique, les citoyens peuvent aussi en être des acteurs. L’État l’a bien compris en France puisqu’il appelle à être « attentifs ensemble » et rappelle que « la sécurité c’est l’affaire de tous ». Pour autant, ils peuvent avoir un rôle plus important que celui de simple exécutant des consignes gouvernementales.
Si le soutien de l’État envers les entrepreneurs nationaux peut encore se développer, les bons contacts noués entre ses institutions et des entreprises ont permis des avancées notables, quand bien même leur diffusion n’est pas encore généralisée. Dans le domaine de la lutte contre la fraude documentaire, une bonne connaissance de la chimie et de l’IA permettent de développer des produits et logiciels à même de réduire les risques de mauvaise identification des personnes.
Enfin, les citoyens concourent également à la sécurité nationale lorsqu’ils mettent en œuvre le continuum de solidarité dont nous avons parlé dans un précédent billet. Ce continuum montre que l’État n’a pas le monopole de l’innovation en matière de sécurité, puisque ce continuum, à contrario du battage réalisé autour du pseudo continuum de sécurité, a une réalité et s’avère efficace lorsqu’il est mis en œuvre. Outre le cas du poser de l’Airbus sur l’Hudson, un tel continuum a été mis en place par les Espagnols lors des inondations de Valence citées précédemment : face à l’inaction de l’État central et de la Région, il a bien fallu que les citoyens s’organisent pour répondre à cette catastrophe.
Conclusion
Dans tous les pays du monde, la majorité des habitants ont une aspiration commune : vivre en paix. Au vu de la complexité du monde actuel, il est illusoire d’estimer que les seuls acteurs de la sécurité (forces de l’ordre et praticiens de la sûreté) sont en mesure d’identifier les problèmes, d’en comprendre les enjeux et d’y trouver les solutions pertinentes. De ce fait, ne pas solliciter les scientifiques et ne pas utiliser les progrès de la science, c’est accepter de demeurer à un niveau de développement adapté à une situation passée, dépassée même, alors que les autres parties prenantes de la sécurité (dont les malfaiteurs) continuent de progresser.
S’il fallait résumer l’intérêt de cette coopération entre praticiens et scientifiques, nous pourrions dire que pour que règne une sécurité satisfaisante, il est indispensable que les scientifiques en développent la partie normée, pendant que les praticiens développent son aspect prudentiel. Le chemin est encore long, mais il n’est pas impossible de substituer aux communautés de pratiques des communautés épistémiques.