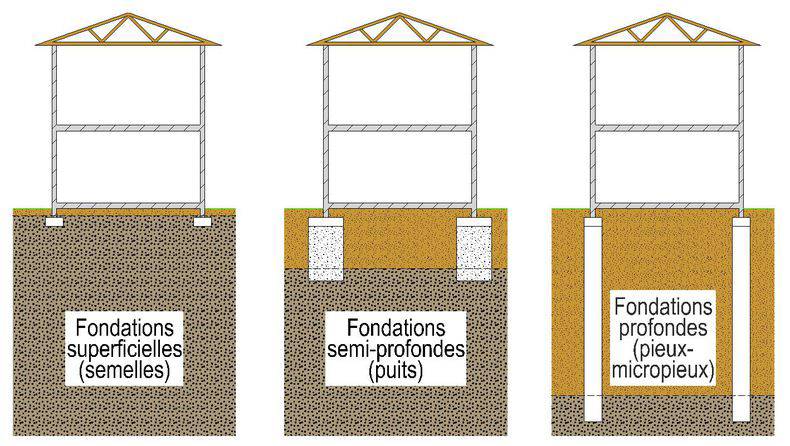Les fondations de la sûreté
Plusieurs articles dans ce blog ont évoqué des questions relatives à la sûreté d’entreprise : sa juridiction, comment la mesurer, ses liens avec le renseignement, des modalités de recrutement (voir ici aussi), son absence de caractère stratégique, la façon dont les chefs d’entreprise la voient, son assimilation à des rites primitifs, son autoportrait. S’ils permettent de se faire une idée, qui n’a pour l’instant pas été contredite, de la sûreté d’entreprise, ils n’évoquent cependant pas le point crucial des fondations de la sûreté, que personne n’a pour l’instant abordé. Si l’on discourt sur la sûreté, argumente sur sa dénomination, le fait qu’elle dépende un peu, beaucoup, passionnément, etc. du praticien, son rattachement dans l’organigramme de l’entreprise (au DRH, au SG, etc.), les débats courent le risque de la vacuité si l’on ne précise pas ce qu’est le socle de la sûreté d’entreprise.
De plus, l’observation des discontinuités de cette fonction au sein de grandes entreprises (longue vacance du poste, rupture forte dans le profil des titulaires) nourrit de légitimes interrogation. Quelles peuvent donc être les fondations de cette fonction originale dans l’entreprise parce qu’elle est l’objet de tant de discontinuités ?

Des discontinuités révélant des fondations instables
Nous partirons du principe que, si les fondations d’une direction sont stables, alors le temps n’a que peu d’effets sur elles. La preuve est apportée par la longévité des fonctions que l’on peut qualifier d’historiques (ou établies) comme la production, les RH, les finances, etc. Nous remarquons que ces fonctions ont des points communs : leur permanence dans l’historie de l’entreprise ainsi qu’une formation commune (ou similaire) de leurs directeurs.
L’histoire de la sûreté d’entreprise révèle au contraire de fortes discontinuités. La première est relative à sa permanence. Si Fayol l’a mentionnée dès 1916 dans son Administration industrielle et générale en estimant qu’elle est une des six fonctions essentielles de l’entreprise (qui sont : technique, commerciale, financière, de sécurité, de comptabilité, administrative) les associations professionnelles de la sûreté sont plutôt récentes : le CDSE existe depuis 1995, l’agora club managers qui inclut l’agora des directeurs sûreté depuis 2008, et l’IEESSE depuis 2019. Cette première discontinuité de près interroge. Pourquoi une fonction essentielle (selon Fayol) a subi une telle éclipse sans qu’aucun dirigeant d’entreprise ne s’en plaigne ?
Une deuxième discontinuité notable se remarque dans les périodes d’occupation des postes de directeur sûreté des grands groupes industriels. Si l’on met de côté le cas de Pernod-Ricard dont le premier directeur sûreté a été nommé en 2018 (alors que l’entreprise a été fondée en 1975 par la fusion de deux entreprises créées en 1805 – Pernod – et 1932 – Ricard), la longueur de la vacance du poste dans d’autres entreprises étonne. Le groupe LVMH a connu une vacance de poste plutôt longue puisqu’après le départ du titulaire du poste en début 2022, son successeur a pris ses fonctions en février 2024. Dans le cas de la Société Générale, après avoir annoncé le départ du titulaire du poste en avril 2024, son successeur n’entra en fonction qu’en octobre 2024, mettant un terme à une vacance de poste de 6 mois. Ces 6 mois sont cependant un minimum dans la mesure où le départ était prévisible dès octobre 2023 (cf. ce billet). Plus près de nous dans le temps, Air France a acté le départ de son directeur sûreté en avril dernier et son successeur prendra son poste en octobre prochain, soit un délai de 6 mois encore. Enfin (parce qu’il faut bien terminer une énumération) Suez qui a vu son directeur sûreté démissionner en décembre 2024 accueillera son successeur en octobre également, soit 9 mois de vacance du poste.
En quoi ces discontinuités révèlent-elles l’instabilité des fondations dans la mesure où certains ont affirmé que ces longs délais s’expliquaient par la volonté d’être sûr de choisir le bon candidat ? Cet argument, aussi séduisant qu’il puisse paraître, est difficilement recevable. S’il était pertinent, cela signifierait que le métier regorge d’imposteurs que les recruteurs n’ont pas encore identifiés, ce qui serait consternant (et renvoie d’ailleurs à une proposition de notre thèse recommandant la formalisation d’une éthique professionnelle, qui constitue au passage une des conditions de la transformation d’un métier en profession, au sens anglo-saxon du terme). Cela signifierait également, et paradoxalement, que la vacance de ce poste n’est pas très grave car l’intérim peut être exercé par l’adjoint (pourquoi alors ne pas le titulariser ?) ou par personne (pourquoi alors recruter ?).
Certes, le cas de chaque entreprise est singulier, mais cela nous amène à reposer la question de l’éventuelle hypocrisie organisationnelle que constituerait la sûreté d’entreprise. Nous sommes d’ailleurs conforté dans cette affirmation par les propos de l’ancien dirigeant du MEDEF qui affirmait lors du dernier colloque du CDSE que tous les chefs d’entreprise étaient conscients de l’importance de la sûreté, mais qu’elle coûtait (trop) cher. Étonnant argument encore, car toutes les entreprises sont assurées (à perte, il faut l’espérer) et nous ne pouvons manquer d’évoquer le financement des sapeurs-pompiers : toutes les communes (ou communautés de communes) payent très chers leurs équipements tout en espérant qu’ils n’interviendront le moins possible. Est-il cependant possible de s’accommoder de cet état de fait en affirmant que la dénomination d’hypocrisie organisationnelle n’est qu’une satisfaction intellectuelle d’intellectuels, l’important étant les actions menées par la sûreté d’entreprise ? Et bien non, car si une fonction est une hypocrisie organisationnelle, alors son titulaire ne peut être légitime (cf. notre thèse). Il a beau affirmer l’être, la question n’est cependant pas de savoir s’il l’est à ses propres yeux, mais si les directeurs de fonctions établies dans l’entreprise l’estiment légitime.
Les discontinuités et la question de l’hypocrisie organisationnelle, tout comme les ruptures fortes de profil des directeurs sûreté successifs, nous montrent que la sûreté, souvent décrite comme dépendant de son directeur, est tout aussi fortement dépendante du dirigeant de l’entreprise. Il convient donc de s’intéresser aux fondateurs et aux fondations de la sûreté.
Fondateurs et fondations
Nous pourrions croire en première approche que la sûreté est une évidence pour les entreprises : la complexité du monde et l’augmentation des menaces imposent à toute entreprise de se protéger et de protéger ses biens en installant une direction sûreté qui repose sur de solides fondations. Ce serait alors avouer une lecture trop rapide de la partie précédente et ignorer le fait que la sûreté est, de facto, en fondation continue tant qu’elle n’est pas aussi fermement établie que les autres directions (financière, juridique, RH, etc.) dans l’entreprise. Cette fondation continue de la sûreté peut étonner, mais deux arguments la justifient. Le premier est l’observation de sérieuses et longues discontinuités dans la direction de la sûreté (cf. supra) qui fragilisent son établissement et questionnent donc sa fondation. Le second est la répétition, par les praticiens eux-mêmes, que l’exercice de la sûreté dépend de son directeur, ce qui interroge également les fondations de cette direction puisque, en poussant le raisonnement, ce que l’un fait l’autre peut le défaire.
Nous en arrivons alors à établir que la sûreté est ainsi fondée par deux personnes : le dirigeant d’entreprise et le praticien. Cette dualité correspond à la dualité de la pratique qui repose sur une partie normée et un partie prudentielle, exposées dans la thèse déjà citée. Cette transposition de la dualité de la sûreté à sa fondation s’effectue ainsi : le dirigeant établit la partie normée de la sûreté dans l’entreprise (ce qu’on peut attendre de la sûreté, dans quelles conditions y fera-t-on appel, comment s’assurer de son effectivité, etc.) et le praticien s’occupe de la partie prudentielle, à savoir sa mise en œuvre. Cette dualité se justifie par le fait que le dirigeant d’entreprise n’a souvent que peu, voire aucune connaissance relative à la sûreté et que le praticien ne connaît souvent pas l’entreprise (en général, et en particulier celle dans laquelle il exercera) lorsqu’il prend son poste. Le dirigeant doit alors montrer sa détermination à faire vivre la sûreté au-delà même des titulaires de la fonction, fixer les missions et les moyens alloués, tandis que le titulaire doit être en mesure d’exposer la doctrine de la sûreté, ce qu’il peut faire pour l’entreprise, se faire connaître et reconnaître par son savoir-faire et la plus-value qu’il apporte à l’entreprise et aux autres directions. Se faire connaître dans l’entreprise est hélas parfois mis de côté, une récente conversation avec un membre de la sûreté d’un grand groupe m’a fait comprendre que le directeur sûreté n’avait pas rencontré individuellement les autres directeurs pour leur expliquer ce qu’il pouvait faire pour eux. S’ensuit un faible appel à ses services et donc une méconnaissance de ce qu’ils pourraient faire.
La preuve de l’importance du dirigeant dans les fondations de la sûreté est apportée par le témoignage de deux praticiens rencontrés dans le cadre de notre thèse. Voici le témoignage de l’un d’eux :
j’étais rattaché en direct au président, pendant environ 4 – 5 ans. Avantages, inconvénients bon on peut en parler, mais, donc à ce moment-là entrée de FF [entreprise] au capital, moment très difficile, sortie du président dans la douleur, et les applaudissements des anciens de UU [son entreprise] et arrivée de W le candidat de FF, qui arrive. À ce moment-là j’ai une étiquette S [le précédent PDG] machin, il n’y avait pas de secrétariat général et il me remet en reporting intuitu personae parce que c’est un report direct au directeur des opérations. Le directeur des opérations et de la transformation qui était son numéro 2 non officiel. Pour me fliquer. Je survis, je passerai sur certaines péripéties mais on n’a pas ma peau, je survis, je fais le boulot, ce n’est pas très épanouissant de ne pas être dans la confiance, mais enfin bon, donc 3 ans 8 mois et 20 jours plus tard lorsque W est débarqué, arrive M. Il n’y a toujours pas de secrétariat général et le directeur des opérations dégage avec W, et est nommé à sa place D et je reste. Changement de style, ça dure 2 ans, c’est un tout petit CODIR il est numéro 2 de M ça se passe très bien, c’est un nouveau machin, M est appelé à prendre GG [entreprise], D qui était mon patron devient président de UU. Bon. Donc là pour une fois la transition simple, j’étais rentré en 2002 dans le groupe je l’avais connu tout petit aussi, on se tutoie, donc c’est quand même assez. Ça ne change pas ni le respect ni le fait que, il n’y a pas d’ambiguïté, mais c’est quand même plus simple.
et celle du second qui vécut également un changement de dirigeant dans une autre entreprise :
Moi quand j’étais patron de sûreté du temps de D qui était le PDG, tous les 2 mois je passais 3/4 d’heure avec lui. Mais depuis ça a bien évolué. Voyez. Et puis quand j’avais ça, dans la société on savait que j’avais la porte ouverte du président. Donc j’étais beaucoup plus à l’aise. Vous comprenez ? Ils savaient que j’avais la porte ouverte du président.
L’intérêt de ces deux témoignages est de montrer qu’un changement de dirigeant peut remettre en cause la légitimité de la sûreté, son positionnement dans l’entreprise et, par voie de conséquence, les missions dont elle est chargée. Pour les directions établies, le changement de patron peut s’accompagner d’un renouvellement des directeurs, mais le contenu des fonctions est rarement remis en cause. Cette remise en cause de la légitimité peut aussi résulter de l’absence de formation à la sûreté : l’absence de formation n’est-elle pas un signe du manque de sérieux de la fonction ? Comment en effet faire confiance à des personnes qui, pour exercer un métier non défini au sein d’un milieu qui leur est inconnu (l’entreprise alors que la majorité ont exercé au profit de l’État) s’appuient sur une expérience que l’entreprise ne donne pas ? Il est alors logique que des ex PDG affirment que le directeur sûreté doit être issu du métier puis formé à la sûreté en interne. Mais comment les entreprises peuvent-elles former à la sûreté leurs apprentis directeurs sûreté alors que celle-ci n’est pas définie et, de plus, n’a pas de doctrine ?
Il est vraisemblable que le terme de doctrine suscitera des réactions de rejet, au motif que le directeur sûreté doit être un pragmatique non un doctrinaire, que la sûreté est un art, etc. Ce serait alors méconnaître le sens du terme doctrine. Car si le dictionnaire de l’Académie française donne comme première définition de la sûreté l’ensemble des principes qui constituent le fondement d’une religion, d’une philosophie, d’une politique, d’une morale il la définit également comme un ensemble de principes et de notions portant sur une matière particulière ; prise de position sur un sujet particulier. Ce deuxième sens autorise alors de chercher à définir une doctrine de la sûreté d’entreprise. Pour prolonger la définition, un certain Robert Prevost a expliqué ce que signifie le terme doctrine : toute doctrine cherche à transmettre une connaissance sûre, ordonnée et systématique de quelque chose. Toute doctrine représente donc une réflexion sérieuse, sereine et rigoureuse sur un objet d’étude. Ainsi, une doctrine n’est pas une opinion, mais une tentative d’atteindre la vérité sur un sujet. La définition de l’Académie et l’explication par ce célèbre Américain nous permettent de regretter qu’il n’existe pas de doctrine de la sûreté d’entreprise pour dépasser les simples bonnes pratiques et remédier à la fragmentation des savoirs, cette absence revenant à la construire sur du sable. Ajoutons qu’il est de l’intérêt du directeur sûreté de connaître cette doctrine (lorsqu’elle existera), car cela lui permettra de refuser (ou d’accepter en toute connaissance de cause) des missions qui ne lui reviennent pas comme faire renouveler rapidement le passeport du fils d’un dirigeant qui a la fâcheuse habitude de les perdre souvent, ou faire sauter des PV…
In fine, la connaissance de la doctrine de la sûreté assoira la légitimité du directeur sûreté car, comme écrit dans un précédent billet, Alain Eraly estime qu’une des conditions de la légitimité est de disposer du savoir utile au groupe que l’on dirige. Comment être certain de disposer de ce savoir si aucune doctrine n’existe ?
Conclusion
Si l’on veut que la sûreté d’entreprise (que nous estimons indispensable aux entreprises au vu de la conjoncture) remplisse les missions pour lesquelles elle a été créée, il devient indispensable d’en établir une doctrine. Notons que le § 4.2 de notre thèse a pour titre Construire une théorie et une doctrine, p 396. Nous précisions dans la suite de ce travail doctoral que Définir une théorie et une doctrine présente aussi l’avantage de permettre leur déclinaison en processus voire procédures pour l’action. Ce ne peut être que bénéfique pour la sûreté qui doit montrer qu’elle aussi, à l’instar des autres fonctions de l’entreprise, est capable d’élaborer des processus (p 397), que il [ne] suffit [pas] d’avoir une doctrine pour réussir, mais que l’absence de doctrine est un handicap certain (p 398). Pour ceux qui seraient tentés de croire qu’une doctrine cristalliserait les savoirs, nous écrivions également Élaborer une théorie et une doctrine ne signifie pas établir un corpus immuable. Comme l’environnement des entreprises évoluera, elles devront également suivre le rythme de ces changements (p 402). De cette doctrine découlera le catalogue de formations utiles à la sûreté, une plus grande légitimité du praticien et, in fine, une meilleure connaissance et reconnaissance de la sûreté par l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Nous nous demandions au début de ce billet quelles étaient les fondations de la sûreté d’entreprise. Nous voyons que l’élaboration d’une doctrine en est un élément essentiel. Peut-être faut-il alors trouver dans son absence une des raisons pour lesquelles la sûreté est méconnue, mal employée et que le poste de son directeur demeure ainsi longtemps vacant, alors que personne n’imagine que la direction des finances, des RH ou de la production demeure vacante plusieurs mois comme ce fut le cas pour les entreprises citées dans ce billet.